
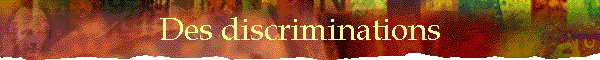
|
|
|
|
Discrimination contre les dhalits(note LK au 09-01-05)
Récit : Il y a une chose que même un tremblement de terre de force 9 sur l’échelle de Richter, et qu’un tsunami qui tue plus de 150 000 personnes, ne peut faire vaciller : c’est le mur qui sépare les castes. Dans le district de Nagapattinam, le plus affecté par la catastrophe, dans le village de Nambiarnagar, 31 familles Dhalits ont été exclues d’un camp de réfugiés, et depuis, elles vivent dans les rues, ne bénéficient pas des aides et doivent se contenter des surplus des distributions d’urgence. Ces familles ne peuvent utiliser les toilettes ou avoir accès à l’eau potable dans les installations mises en place par les agences de l’ONU. C’est pourquoi certaines ONG ont dû construire des équipements spécifiques pour ces familles. (article du Indian Express du 7-1-05).
Liste des discriminations subies par des communautés Dhalits :
La liste a été établie par HRFDL en collaboration avec NESA et NCDHR. De la part des communautés de pêcheurs, on doit se souvenir que les communautés de pêcheurs appartiennent en général à la caste Chettiyar ou à d’autres castes (dans le district de Nagapattinam). -Les pêcheurs ne tolèrent pas que les Dhalits restent dans des camps d’urgence. -Les pêcheurs ne permettent pas la distribution de l’aide aux Dhalits. -Les pêcheurs stigmatisent les Dhalits comme mendiants, voleurs, paresseux… -Les pêcheurs brûlent des corps de leurs communautés dans les villages Dhalits, -Les pêcheurs donnent aux Dhalits les aides d’urgence qui sont en surplus dans leurs propres communautés, ou qui sont abîmées ou périmées ou refusées par les communautés de pêcheurs.
De la part des autorités publiques : - Ne garantissent pas l’accès aux camps de réfugiés. - N’assurent pas l’aide d’urgence, l’aide médicale. - Ne rendent pas visite aux camps de Dhalits organisés par eux-mêmes. - Sont apathiques pour enregistrer les Dhalits comme victimes. - Refusent d’enregistrer les Dhalits comme personnes disparues. - Refusent d’enregistrer les dégâts causés aux colonies Dhalits. - Obligent les Dhalits à s’occuper des carcasses des animaux morts. - Obligent les Dhalits à nettoyer les zones non Dhalits. - Obligent les Dhalits à faire des travaux indignes ou dégradants.
Discriminations contre les Dhalits engagés dans le travail d’aide humanitaire -On ne donne pas aux Dhalits le matériel approprié : masques, gants, bottes pour travailler avec des carcasses ou des cadavres. -On ne paye pas les Dhalits pour les heures supplémentaires. -On ne donne pas aux Dhalits les primes pour transport. -On ne procure pas de logement aux Dhalits travaillant loin de chez eux. -Pas de soins ou d’accès aux sanitaires pour les Dhalits. -Pas de mesures préventives contre les maladies ou de précautions pour les risques pris.
Mesures à envisager pour porter remède à ces situations - Concentrer l’action de certaines ONG sur les villages Dhalits victimes. - Collecter les informations sur les diverses formes de discrimination. - Créer dans chaque village et camp un comité de vigilance. - Faire la liste des pertes humaines et des dommages subis par les Dhalits. - S’engager dans un travail de lobbying et de plaidoyer, y compris vis-à-vis des médias. - Faire un suivi des aides gouvernementales dans les villages Dhalit. - S’assurer que les banques et institutions financières consentent des micro crédits aux Dhalits pour la relance de leur capacité d’autofinancement. HRFDL et NCDHR (avec NCSA, PW-TN ; RDS, DHRC, Janodayan, IRDS et DLRF) s’engagent dans ce sens.
Les actions entreprises par HRFDL et NCDHR : - Recensement des pertes humaines. - Recensement des dommages subis par les Dhalits, réalisé dans les 53 villages du district de Nagapattinam. - HRFDL a distribué 10 tonnes de riz, des habits, des ustensiles de cuisine, des nattes pour dormir, des couvertures… - Conférence de presse à Mylathuthurai le 07/01/05 avec des articles de journaux dans les grands quotidiens : Indian Express, Star, ND TV, The dinamain Tamul Journal, etc… - Plaintes déposées auprès du préfet et du gouvernement du Tamil Nadu, et du gouvernement fédéral. - Diffusion d’informations aux ONG locales et internationales (réseau IDSN).
Les résultats obtenus : - Articles publiés dans les grands quotidiens régionaux et nationaux. - Emission diffusée à la BBC/CNN/France 2. - L’OIT avec beaucoup d’ONG a exprimé ses préoccupations ainsi que beaucoup de membres de collectifs nationaux de IDSN dans les pays européens : DSN UK, DSNDenmark, DSN Norvège, Allemagne, etc…) et aux Etats-Unis (DSN USA et Human Rights Watch relaient ces actions auprès du gouvernement de Washington).
« Les Intouchables indiens ramassent les morts du raz-de-marée »Traduction française de l’article « India's untouchables gather tsunami dead » de l’agence Reuter, 3 janvier 2005. NACAPATTINAM, Inde. Ils sont appelés les « intouchables », les derniers d’entre les derniers dans le système ancestral des castes en Inde. Aucun travail n’est considéré comme trop sale ou trop désagréable pour leur être assigné, ils sont ceux qui nettoient les corps en putréfaction dus au raz-de-marée meurtrier de la semaine dernière. L’écrasante majorité des quelques 1000 hommes suant sous la chaleur tropicale pour nettoyer la modeste ville de pêcheur d’Inde du sud de Nagapattinam qui a subi le choc de la gigantesque vague sont des Dhalits venant des villages alentours. Les habitants de cette ville trop effrayés par des risques de maladie et trop indisposés par l’odeur refusent de joindre leur efforts à la sinistre tâche : il faut extraire du sable et des débris les corps des amis et des voisins. Bien qu’il se soit écoulé une semaine depuis le raz de marée, et que les destructions soient confinées à une mince bande du littoral de la plage au port, les dégâts sont d’une telle ampleur que des corps sont encore découverts tous les jours, localisés par la puanteur et les essaims de mouches. « Je fais juste ce que j’aurai fait pour mes propres femme et enfants », déclare M. Mohan, un agent municipal d’entretien, alors qu’il prend une pause pour se nettoyer un peu de la saleté du travail du jour. “C’est notre travail. Si un chien meurt ou une personne, nous devons nettoyer.” Mohan et les autres agents d’entretiens des municipalités voisines travaillent 24H/24 pour nettoyer Nagapattinam, avec à la clé 50 cents (20-25 roupies ?) par jour et un repas. L’odeur de la mort est toujours fortement présente, mélangée à la brise marine ainsi qu’à l’aigre parfum, plus ou moins rafraîchissant, de la poudre antiseptique citronnée qui blanchit certaines rues et allées. Plus de 5 525 personne – près de 40% des 14 488 victimes estimées pour l’Inde- sont mortes le long de cette petite bande de plages d’un blanc pur, où les huttes des modestes pêcheurs étaient construites à même le sable directement sur la plage. Sur une population de plus d’un milliard d’habitant, 16% des indiens sont des Dhalits. Malgré les lois condamnant la discrimination par caste, ils sont encore quotidiennement humiliés, maltraités et parfois même tués. Ils font les travaux dont les autres ne veulent pas: ils nettoient les toilettes, collectent les ordures et dépècent les vaches. Pour Mohan, illettré, n’ayant que peu
fréquenté l’école, et appartenant à une basse caste, la seule voie pour
travailler dans les services publics et bénéficier de la sécurité et de la
pension qui vont avec, était cet emploi d’agent municipal d’entretien. Il y a seulement deux ans, 5 dhalits ont été lynchés près de New Delhi après qu’une rumeur ait répandu qu’ils auraient tué et dépecé une vache, vénérée comme un animal sacré en Inde. Une autopsie fut conduite sur la vache –aucune ne fut menée pour les Dhalits- et confirma l’histoire racontée par leurs amis: la vache était morte d’une autre cause et ils étaient donc en train de la dépecer légalement. Aux premières heures du désastre causé par le raz-de-marée, Mohan et ses collègues travaillaient fiévreusement parmi les centaines de corps, sans gants, sans masques et même sans chaussures dans certains cas. Maintenant ils sont mieux équipés. Mais aucun masque ne stoppe l’odeur suffocante de la chair humaine en décomposition, qui devient de plus en plus puissante à mesure que les corps sont dégagés. Cette odeur vient se fixer tenacement loin au fond de la gorge. Chaque nouveau corps découvert est soutiré avec précautions au sable mouillé, palmes déchirées des cahutes et autres débris. Et ce travail se fait essentiellement à la main. C’est une tâche dure où l’on sue et se casse le dos. Après avoir déplacé sable et déchets, la simple position redressée devient douloureuse. Pourtant le travail avance peu à peu, précautionneusement et patiemment, avec respect et délicatesse pour les victimes. Mais il n’y a plus de dignité. Le corps quasi méconnaissable d’une femme nue, un pied encore sec, propre et blanc de façon surprenante, comme si elle sortait juste d’un bain, est porté sur une natte sur la plage. Un peu plus loin, un petit bûcher est allumé avec un pneu et des feuilles de palm. La femme y est hissée. Une autre natte fournit comme un dernier pitoyable rempart de protection à sa pudeur Des discriminations au quotidien, une sorte d'Apartheid
1. Discriminations dans le lieu de vie :Les Dhalits doivent habiter une «colonie», un espace à l'écart du village où vivent les gens de caste. Les gens de caste n'iront jamais dans la «colonie» des Dhalits, qui par contre sont appelés chez les gens de caste pour le travail, mais ne sont généralement pas autorisés à entrer dans l'intérieur des maisons (et en particulier jamais dans la cuisine). Une véritable ségrégation de l'habitat, qui permet de dire que les 600.000 villages indiens sont en fait 1.200.000 !
2. Discriminations dans l'accès à l'eau et à l'électricité :Traditionnellement, tous les puits se trouvaient dans le village et sous le contrôle des gens de caste, qui ne permettaient pas aux Dhalits de s'y servir directement. Les Dhalits devaient donc aller chercher l'eau directement à la mare ou la rivière, souvent éloignées et non potables, ou parfois se contenter d'une distribution ponctuelle de quantités limitées d'eau du puit. Aujourd'hui, cette pratique continue mais le Gouvernement depuis les années 70 développe des forages et installe des réservoirs : en pratique, cela se traduit par un forage pour le village de caste, et parfois un pour la colonie Dhalit si ces derniers se mobilisent pour le réclamer. Cependant, en raison des tensions fortes pour l'accès à une eau de plus en plus rare, les forages dans la colonie Dhalit sont maintenant prévus de manière systématique. En cas de forage unique, le réservoir collectif prévoit plusieurs robinets dont certains réservés aux Dhalits.
3. Discriminations dans l‚accès aux biens communaux :L'accès aux ressources naturelles et communes du village (zone boisée, réservoir d'eau et poissons, arbres fruitiers, pâturages, propriétés du temple) était interdit aux Dhalits il y a peu de temps encore. Aujourd'hui, leur accès y est toujours restreint, ils doivent le négocier en permanence. Ainsi, pour faire paître leur bétail, ils doivent demander la permission d‚accéder aux pâturages communaux auxquels les gens de caste ont un accès totalement libre.
4. Problèmes d‚accès à l‚éducation, aux emplois et mandats publics :Dès l'époque coloniale britannique, les autorités ont mis en place un système de discrimination compensatoire au moyen de «quotas» (réservations) pour les Dhalits afin de favoriser leur accès à l'éducation publique, aux emplois dans l'administration, et aux sièges électoraux nationaux et locaux. Constamment discuté et remis en cause, ce système ne contribue en fait qu'à l'émancipation d'une petite proportion de Dhalits (moins de 2% selon les statistiques officielles). Les quotas sont loin d'être respectés, les postes qui leur sont réservés restent souvent vacants. Dans l'administration, les Dhalits demeurent généralement à des postes subalternes quels que soient leurs mérites et compétences. Officiellement 97% des Dhalits seraient exclus du bénéfice des réservations.
DES CONDITIONS D'EXPLOITATION EXTREME DANS LE TRAVAIL
80% des Dhalits survivent en tant qu'ouvriers agricoles saisonniers, et ouvriers non qualifiés dans la construction et l'industrie de sous-traitance. Traditionnellement, les Dhalits n'ont pas le droit d'être propriétaires de terres. A l'Indépendance, les terres étaient aux mains de grandes familles féodales contrôlant des villages entiers et ceux qui y vivaient : métayers (de castes moyennes) et ouvriers agricoles (massivement intouchables). Des lois de réforme agraire successives (de 1951 à 1975) ont tenté, pour moderniser l'agriculture, de briser cette concentration. Résultat : les castes moyennes sont devenues propriétaires, mais les intouchables sont toujours ouvriers agricoles, en situation de quasi-esclavage.
Depuis l'époque britannique, des programmes de distribution des terres aux Dhalits ont bien été mis en oeuvre (terres Panchami), mais il s'agit de très petites surfaces (un quart d'hectare par famille en moyenne), de qualité marginale, rarement irriguées, insuffisantes pour les faire vivre. Des terres bien souvent récupérées par les gens de caste du village soit par force, soit par le biais de l'usure (terres hypothéquées). Malgré les succès relatifs de la Révolution Verte, et la modernisation de l'agriculture, la situation socio-économique des intouchables en milieu rural n'a donc pratiquement pas progressé depuis 50 ans, et 80% des ouvriers agricoles sont Dhalits
Le travail forcé au village reste une pratique courante : il s'agit d'activités non rémunérées, au service personnel de familles des castes supérieures (travail agricole sur les parcelles des hautes castes, travaux domestiques). Si les dhalits ne s'y soumettent pas, ils subissent un ostracisme ou un boycott social, on ne leur donne plus de travail au village.
Hommes, femmes et enfants trouvent également du travail non qualifié, souvent saisonnier, comme ouvriers dans les chantiers de travaux publics et privés, les carrières, les briqueteries, et la sous-traitance industrielle. Des villages entiers de Dhalits migrent saisonnièrement vers les villes à la recherche d'un travail, ou pour mendier. De plus en plus de femmes travaillent dans de petits ateliers ou à domicile dans la confection, la taille de pierres artificielles, la fabrication de beedis (cigarettes locales), de bracelets etc. Des activités aux salaires de misère, et ne bénéficiant d'aucune protection de la législation du travail.
Des secteurs où l‚on trouve aussi une forte proportion de travailleurs liés («bonded labor»), une forme d'esclavage pour dette qui en Inde concerne au minimum dix millions de personnes, en majorité des Dhalits, et que les statistiques officielles refusent de prendre en compte. Certaines organisations parlent même de 65 millions. Ce travail à vie pour rembourser une dette se transmet souvent de génération en génération, et concerne donc beaucoup d'enfants. Il concerne également des secteurs de production à l'exportation, dont les tapis sont un exemple significatif. |
|
Envoyez un courrier électronique à
webmaster@terreindienne.org pour
toute question ou remarque concernant ce site Web.
|