
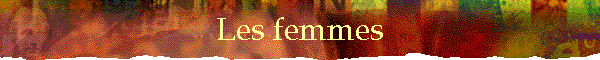
|
|
|
|
L'HISTOIRE DE LALITA : La transformation par l'éducation. INDE : Vive le pouvoir des femmes ! Nari shakti, zindabad !
Histoire de femmes
C'est grâce aux initiatives de Ela Bhatt, une Indienne avocate de formation, que la SEWA existe aujourd'hui. Au départ, la SEWA est issue du plus vieux et plus grand syndicat de l’Inde, soit le « Textile Labour Association (T.L.A.) » fondé en 1917, par le célèbre Mahatma Gandhi. Ela Bhatt était membre de ce syndicat et décida que ce dernier avait besoin de créer une section spéciale pour défendre les conditions de travail des femmes. Ainsi, fût créée en 1954, la « Women’s Wing ». Ela Bhatt s’aperçu toutefois que la « Women’s Wing » ne rejoignait pas les femmes du secteur informel et décida de créer la SEWA, en décembre 1971. Cette organisation est donc née dans un mouvement de travail où l’idée voulait que les femmes auto employées, tout comme les femmes salariées régulièrement, aient droit à des salaires et des conditions de travail décentes, ainsi que des lois pour les protéger. Après une dure bataille, en avril 1972, la SEWA fût enregistrée comme syndicat, sous « L’Indian Trade Union Act » de 1926, à Ahmedabad, dans l’État indien du Gujurat. En 1981, toutefois, les relations entre la SEWA et la T.L.A. se sont détériorées, du fait que les intérêts de la T.L.A. de représenter les travailleurs du secteur formel sont devenus en conflit avec les demandes grandissantes de la SEWA de représenter les femmes du secteur informel. La T.L.A. a finalement expulsé la SEWA. Toutefois, l’indépendance de la SEWA fût une bonne chose, car cela lui permis d’accroître ses effectifs encore plus rapidement, de débuter de nouvelles initiatives, de se définir de nouvelles lignes directrices et de devenir un syndicat encore plus militant. La SEWA est un syndicat structuré démocratiquement qui s’est donné des moyens auxiliaires impressionnants: des coopératives dans plusieurs domaines différents, un programme de formation à différents niveaux. Ce syndicat révolutionnaire a permis à des milliers de femmes indiennes d’améliorer leur qualité de vie et de faire reconnaître leurs droits. Ce modèle exceptionnel a d’ailleurs été repris à d’autres endroits dans le monde. Les syndicats indiens, reconnus dans le secteur formel, ont longtemps contesté à la SEWA sa qualité de syndicat. Selon eux, la SEWA est une organisation non gouvernementale (O.N.G) parce que ses membres ne sont pas des salariées dans le sens traditionnel et légal du terme. Mais la SEWA a bel et bien été reconnue comme organisation syndicale par les Secrétariats professionnels internationaux (SPI). C’est un syndicat qui a voulu aider une classe de personnes qui habituellement, était considérée comme extérieure à tout syndicat existant. Ainsi, la SEWA est un syndicat tout à fait différent des syndicats traditionnels auxquels nous sommes habitués, mais un syndicat qui a réussit à trouver la voie de la réussite.
De nouvelles compétences aident les femmes à gagner plus d’argent
Dans de nombreuses régions du monde, ce sont les femmes qui cultivent les champs, font les courses, la cuisine et nourrissent leur famille. Elles s'occupent aussi des membres de la famille qui tombent malades. Alors quand les femmes dépensent leur argent, c'est pour le bien de la famille entière et pas uniquement pour elles. Mais quand la saison des cultures s'achève, de nombreuses femmes ouvrières agricoles n'ont plus de ressources, alors la santé et le bien être de leurs familles peuvent en pâtir. Ne serait ce pas merveilleux si les femmes pouvaient travailler ensemble durant la morte saison pour gagner de l'argent à côté pour leurs familles mais aussi pour elles mêmes ? Hé bien, elles le peuvent! Ecoutons le Dr Sara Bhattacharji raconter l'histoire de ces femmes du sud de l'Inde qui ont changé leur vie lorsqu'elles se sont groupées pour acquérir de nouvelles compétences.
Dans les villages autour de Vellore, la récolte venait de s'achever. Il n'y avait plus de travail à faire sur les fermes et il ne restait plus beaucoup d'argent pour la nourriture et les habits. Alors un groupe de jeunes femmes, désireuses d'aider leurs familles, demandèrent à des agents de santé communautaire de les aider à trouver les moyens de se faire des revenus stables toute l'année. Le Dr Sara Bhattacharji et ses collègues, travaillant dans le cadre du programme de santé communautaire du "Christian Medical College" de leur district, aidèrent les femmes à trouver un enseignant compétent d'un district voisin qui pouvait leur inculquer de nouvelles compétences et un nouveau savoir faire comme la vannerie ou la tapisserie. Avec ce savoir faire tout neuf, les femmes seraient capables de fabriquer des produits qu'elles pourraient vendre. Leur professeur leur apprit comment confectionner de beaux paniers en feuilles de palmiers qui se vendent bien. Bientôt les femmes gagnèrent assez d'argent pour améliorer l'ordinaire de leurs familles, réparer leurs maisons ou acheter des médicaments quand quelqu'un tombait malade. Et toute la famille s'en portait bien.
Puis un second groupe demanda à apprendre la couture pour économiser de l'argent en confectionnant leurs propres habits. Elles pouvaient ainsi gagner plus en confectionnant des habits et les vendre. D'autres groupes s'aventurèrent dans des tâches qui étaient jusque là réservées aux hommes. Un groupe apprit la soudure, même si cela voulait dire manipuler des chalumeaux à haute température et du métal brûlant. Elles fabriquent maintenant des étendoirs pour sécher le linge, soudent des barreaux et des cadres de fenêtres, et font mêmes des soudures pour les bâtiments plus imposants à l'hôpital où travaille le Dr Sara Bhattacharji.
Un autre groupe demanda à apprendre la confection de briques et la maçonnerie. Lorsque le Docteur et ses collègues leur dit que cela pouvait être dangereux, les femmes se sont mises à rire. "Ecoutez docteur. A votre avis que sommes nous en train de faire ?" demanda leur chef. "Nous transportons des paniers de terre, des briques et du ciment sur nos têtes sur les échafaudages pour les donner aux hommes. C'est tout aussi dangereux, et nous sommes mal payées." Alors le groupe de santé communautaire organisa des cours de maçonnerie pour elles. Elles ont bâti le centre communautaire où les groupes de femmes suivent leurs cours. Les femmes sont irréprochables, ce sont des travailleuses appliquées, alors elles obtiennent de bons emplois bien payés. Le fait de gagner plus d'argent a changé d'autres aspects de la vie de ces femmes. Au début ce n'étaient que des changements mineurs. Lorsque les femmes se sont parlées durant les cours, elles découvrirent qu'elles désiraient toutes la même chose. Elles avaient toutes les mêmes problèmes. Alors chacune réalisa qu'elle n'était pas seule. Bientôt les femmes comprirent qu'elles pouvaient faire en groupe des choses qu'elles ne pourraient pas faire seules, comme aller acheter de nouveaux habits ou aller au cinéma. Traditionnellement, les femmes de ces villages n'avaient pas l'autorisation de sortir seules. Elles devaient attendre que leur père, leur frère ou leur mari vienne les chercher. Mais maintenant elles pouvaient faire partie d'un groupe. Le fait de savoir qu'elles pouvaient faire des choses de façon autonome leur donnait une plus grande confiance en elles.
Lentement, les femmes commencèrent à envisager de changer les coutumes et les pratiques qui n'étaient pas justes ou qui étaient dangereuses. Traditionnellement dans cette région, les parents ont l'habitude de marier leurs filles très jeunes, même dès l'âge de 12 ou 13 ans. Cela aussi voulait dire qu'elles commençaient à avoir des enfants très jeunes. Et souvent cela affaiblissait à la fois la mère et les enfants. Maintenant les femmes parlaient de ces problèmes. Des filles célibataires dans les groupes commencèrent à dire qu'elles se marieraient seulement quand elles seraient prêtes. Et puisque tout le groupe était derrière elles, cela a marché. Ainsi l'âge moyen pour se marier dans cette communauté augmenta de 15 à 21 ans. Cela veut dire des mères en bonne santé et des bébés sains.
Elles apprirent également à accepter les coutumes et les opinions des autres, car de nombreux groupes sociaux et religieux différents cohabitent dans ces villages. Habituellement les membres de chaque groupe restent entre elles et ne se mêlent pas beaucoup aux autres. Mais comme les femmes de différents groupes se fréquentent dans les cours d'artisanat, elles sont devenues amies. Au début, les hommes trouvèrent difficile d'accepter les changements. Les vieux avaient le sentiment que les femmes devenaient trop effrontées et manquaient de respect parce qu'elles ne marchaient plus la tête baissée, les yeux rivés au sol comme avant. Les jeunes hommes étaient furieux de voir les jeunes femmes devenir aussi indépendantes. Les hommes oubliaient que cet argent que les femmes gagnaient à côté leur rendait à eux la vie plus facile.
Une nuit, les jeunes hommes du village de vanniers étaient tellement en colère qu'ils mirent le feu au centre communautaire où se donnaient les cours d'artisanat. Sans endroit où travailler, les femmes cessèrent la pratique de leur artisanat. Privées de cet argent gagné en plus, des familles entières souffrirent. Lentement les jeunes hommes réalisèrent l'erreur qu'ils venaient de commettre. Après deux ans, les mêmes jeunes hommes qui avaient mis le feu au centre acceptèrent d'aider à le reconstruire. Même s'ils ne l'ont pas encore fait, les femmes ont repris leurs cours dans un local loué. Et maintenant les hommes soutiennent leurs activités.
Tout cela a commencé il y a plus de cinq ans. Le groupe de maçonnerie continua environ trois ans. Le groupe de soudure travaille toujours même s'il est plus réduit. Cependant le groupe des vanniers et celui des travailleuses de fibres de sisal est devenu plus important. Elles ont maintenant formé une coopérative avec plus de 700 membres. Leurs production est non seulement vendue sur les marchés locaux mais aussi exportée vers d'autres régions de l'Inde et même à l'étranger. Et même si certains groupes ont disparu, les femmes ont appris une chose essentielle : l'union fait la force. Les hommes, de leur côté, ont appris que certains changements dans les anciennes coutumes peuvent avoir du bon. Et pour le bien de tous, la santé et la nutrition des gens de la communauté ont connu une amélioration. Les informations issues de ce texte nous proviennent d'une entrevue entre Vrinda Kumble et le Dr. Sara Bhattacharji, Community Health Department.
Une déléguée du personnel... Intouchable
Sabine BENJAMIN
J'ai rencontré Vennila et Kuramam dans les locaux de RISE le mercredi 7 février 2001, à Pondichéry. Vennila, 29 ans, mariée, mère de famille, vit dans un village près de Pondichéry, au sud de l’Inde. Depuis 11 ans, elle travaille comme ouvrière dans une usine de cuir (confection et maroquinerie). Dans cette usine, 99% des ouvriers sont Dhalits et cela n’est pas une coïncidence. En effet, en Inde tous les travaux considérés comme impurs et dégradants (dont le traitement des peaux, des ordures…) sont réservés à cette catégorie de la population. Vennila qui a longtemps considéré les discriminations contre les Dhalits comme une fatalité est déléguée du personnel dans son usine, depuis septembre 2000.
Expropriations Et puis, il y a 15 ans, le gouvernement régional a décidé de mettre en place une politique de développement économique, en favorisant l’implantation d’industries chimique, de cosmétique et de plastique près de Pondichéry. Dans cette zone franche, les entreprises bénéficient d’une totale exonération d’impôts et de charges, pendant les 5 années suivant leur installation. De très nombreux propriétaires terriens ont réalisé de fructueuses affaires en vendant leurs terres, cultivables ou non, aux compagnies indiennes et étrangères qui souhaitaient s’installer. Les Dhalits ont donc massivement perdu leur emploi et ont été contraints à déplacer leurs villages, sur les rares terres gouvernementales disponibles. Aujourd’hui encore, ils doivent se battre afin de disposer de commodités de base telles que, l’accès à l’eau potable, à l’électricité, à une route digne de ce nom… RISE a épaulé ces villageois dans leur reclassement professionnel. Leur faible
niveau de formation et leur statut d’inférieurs ont engendré une exclusion quasi
systématique des opportunités d’emplois proposées par les entreprises
nouvellement implantées. 8 jours de congés par an... Créée il y a 22 ans, cette usine compte près de 1 300 employés. Sa production est exclusivement réservée à l’exportation vers la France, la Hollande et l’Allemagne. Les salariés y travaillent 10 heures par jour, 6 jours sur 7 et ont légalement droit à 8 jours de congés payés par an et à 1/2 heure de pose déjeuner, dont ils peuvent très rarement jouir, pour cause de carnet de commandes trop rempli.
Le salaire journalier légal dans ce secteur d’activité est de 45 roupies (6,45 F) mais celui pratiqué dans cette usine s’élève à 15 roupies (2,15 F). Aucune pension de retraite, ni couverture sociale ne sont prévues hormis pour les grossesses (3 mois de congés payés). Dhalit rebelle Face à cette situation d’injustice, Vennila a décidé de s’engager dans la lutte et a suivi une formation en droit du travail dispensée par RISE. Elle est intimement persuadée que cet employeur bafoue les lois les plus élémentaires du travail depuis si longtemps sans être inquiété parce que la grande majorité de ses salariés sont Dhalits. Tous les contrôles des entreprises ont jusqu’à présent été menés avec une grande complaisance par des fonctionnaires souvent corrompus et appartenant à des castes supérieures comme leur patron. Le statut d’inférieurs des Dhalits et leur crainte de se mobiliser ont longtemps été une garantie d’impunité pour ceux qui les abusent. Vennila a donc décidé de mener un combat, par voie légale, pour faire entendre leur voix. Cette dernière a formulé des revendications précises à partir de la législation en vigueur dans cet état. Elle réclame donc l’application du salaire légal, l’interdiction du travail des enfants afin de leur permettre d’avoir accès à une éducation de base, des contrats de travail et des fiches de paie, le respect de la pause déjeuner et des congés payés, la reconnaissance des problèmes de santé inhérents aux conditions de travail (problèmes oculaires, circulatoires, d’allergies et respiratoires dus aux produits chimiques inhalés…), le port d’un uniforme pour éviter la dégradation des vêtements des ouvriers, et la possibilité de bénéficier d’une formation professionnelle. Il y a 5 ans, pour contrecarrer ces revendications, son employeur a créé un syndicat dans sa propre usine. Jusqu’à présent les représentants du personnel étaient des employés choisis pour leur «docilité». Election libre En septembre 2000, grâce à une pression extérieure des autorités locales, obtenue de haute lutte par Vennila avec le soutien de RISE, l’employeur a du procéder à une élection libre. Malgré les menaces et le faible nombre de salariés officiellement engagés (15 sur 1300), Vennila a été élue avec son collègue Kuramam qui travaille dans cette usine depuis l ‘âge de 9 ans. Bien qu’aucune de leurs revendications n’aient abouti pour le moment et qu’ils aient déjà subi 2 suspensions (de 10 et 20 jours) sans indemnités, le résultat de cette élection est une première victoire et une reconnaissance de la pertinence de leur combat. Les objectifs, les enjeux et les conséquences de ce combat dépassent largement des revendications purement professionnelles. En effet, Vennila et Kuramam considèrent qu’il démontrera aux Dhalits qui craignent encore de s’engager, que la prise de conscience de soi, de ses droits et le combat légal contre les discriminations, permettront aux Dhalits d’être reconnus en tant qu’êtres humains à part entière, de faire entendre leur voix, et par là même, d’améliorer leurs conditions de vie.
Articles "PEUPLES EN MARCHE" sur les Dhalits
La condition de la femme Indienne Beaucoup de femmes mariées ou prêtes à l'être sont assassinées par leur mari (ou futur) avec la complicité de la famille de celui-ci parce que la dot de la fille est insuffisante ! Cet acte monstrueux prend, une fois de plus, racine dans la tradition indienne... Opprimée jusqu'à la plus petite parcelle de leur être, les femmes indiennes n'ont, en tant qu'adulte, aucune garantie de jouir de leurs droits et de leur liberté au même titre que les hommes. Elles sont soumises à des lois sur le statut personnel fondées sur des règles religieuses qui renforcent l'inégalité par rapport aux hommes en matière de divorce, de droits sociaux de base et de droits successoraux. D'un autre côté, le viol des femmes est à ce point fréquent, qu'il a pu être classé en neuf catégories : dans la communauté, collectif, touchant particulièrement les filles mineures, marital, commis par les membres de l'armée ou de la police, dans les institutions (hôpitaux, détention provisoire, prisons), dans une situation de dépendance économique, au sein d'organisations politiques. Pour les femmes qui auront échappé à cette discrimination outrancière durant les deux premiers tiers de leur vie, il leur reste l'angoisse de l'attente de la mort de leur époux qui signera dans beaucoup de cas (notamment dans les villages) leur propre mort. C'est la pratique encore courante du Satî où la veuve doit s'immoler d'elle même (bien souvent contrainte) sur le bûcher où est en train de brûler la dépouille de son mari. Cette pratique ne touche pas uniquement les veuves âgées mais aussi les jeunes épouses dont le mari viendrait à décéder prématurément. D'autres pratiques ont aussi court comme la mise à mort systématique de femmes soupçonnées de sorcellerie. Le gouvernement, même s'il a montré quelques volontés de changer les lois pour essayer de faire évoluer les esprits vers plus d'humanité à l'égard des femmes, est freiné par le poids des traditions et de la conscience collective qui sont encore bien trop puissant.
"Pourquoi es-tu venue au monde, ma fille, quand un garçon je voulais ? Vas donc à la mer remplir ton seau : puisses-tu y tomber et t'y noyer" chanson populaire de l'Inde... |
|
Envoyez un courrier électronique à
webmaster@terreindienne.org pour
toute question ou remarque concernant ce site Web.
|