
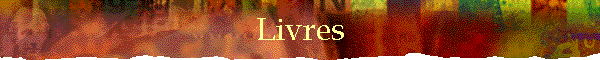
|
|
|
Spécial Inde L'Express du 20/12/2004 Des lettres capitales Par André Clavel Le sous-continent est un vivier de l'imaginaire. Que ses écrivains y restent ancrés ou qu'ils s'expatrient, qu'ils soient d'expression anglaise ou choisissent parmi la myriade de ses langues, tous racontent l'histoire passionnée de leur pays. Une manne universelle Si l'Inde est un éléphant qui s'ébroue lentement, sa littérature, elle, est une tigresse dont le flamboyant pelage ne cesse de nous éblouir depuis deux bonnes décennies. A tout seigneur, tout honneur: c'est Salman Rushdie qui fut le premier à sortir les griffes lorsqu'il parachuta sur la planète ses incomparables Enfants de minuit. Dans son sulfureux sillage, la littérature indienne a carrément explosé, en un raz de marée aussi magistral que le grand boom latino des années 1960. On a alors découvert que les romans concoctés au pays de Tagore n'étaient pas «une sorte d'opium hindouiste pour intellectuels occidentaux» - comme le prétend Taslima Nasreen - mais une manne universelle, un véritable vivier de l'imaginaire. Normal: avec ses 15 langues officielles et sa myriade de dialectes, avec ses 20 000 éditeurs qui publient 700 000 nouveautés par an, l'Inde est un continent où le verbe déferle en une polyphonie quasi babélienne. Comme dans ces coffee houses de Calcutta qui, le soir, se remplissent de milliers de poètes amateurs dont les plaquettes, reliées sur des coins de table, passent de main en main sous le bourdonnement des ventilateurs. L'intimité charnelle d'un continent souvent réduit à ses haillons de misère et à une poignée de clichés exotiques Pas étonnant, donc, que les lettres indiennes essaiment tous azimuts, sous la bannière de la world fiction et de la liberté reconquise: au moment où le vieil Empire vacillait, les rejetons de l'ex-colonie ont su saisir leur chance, pour devenir les nouveaux maîtres d'une culture dont leurs pères avaient été exclus. Ceux que l'on connaît le mieux, en Occident, s'expriment en anglais. Mais cet anglais-là, ils l'assaisonnent à leur manière, fort épicée, en un bouillonnement novateur qui leur permet de mêler allégories politiques, chroniques sociales et extravagances baroques. Aussi tous ces défricheurs sont-ils des champions du métissage culturel et linguistique, car beaucoup ont choisi les chemins de la diaspora, entre la Grande-Bretagne, le Canada et les Etats-Unis. En tête du cortège, l'auteur des Versets sataniques, virtuose du réalisme magique qui, de son exil londonien, a réinventé le bruit et la fureur de sa terre natale. A ses côtés, Vikram Seth, cet enfant de Calcutta passé par Oxford, dont Un garçon convenable - époustouflante saga familiale repeinte aux couleurs de l'indépendance - a frôlé les 100 000 exemplaires en France. Même score pour Arundhati Roy, la redoutable pétroleuse féministe, globe-croqueuse couronnée d'un Booker Prize, le Goncourt britannique. Son Dieu des petits riens est devenu emblématique: un déluge d'images et de parfums, un gigantesque travelling qui embrasse toute l'Inde d'aujourd'hui, déchirée entre archaïsme et modernité galopante - «Un mélange de marxisme à l'orientale et d'hindouisme orthodoxe corsé d'une pointe de démocratie», dit-elle. Une littérature furieusement chevillée à l'Histoire. Tous ces romanciers cultivent leur singularité mais ils ont des points communs, et c'est ce qui fait la cohérence de la littérature indienne: elle est furieusement chevillée à l'Histoire, aux débats sur la partition, l'indépendance, la décolonisation, la menace intégriste, les conflits de classes et de castes. Lire un roman indien, c'est être plongé dans la fièvre d'une terre chamboulée, c'est survoler des périodes qui couvrent presque toujours plusieurs générations, c'est se frotter à l'intimité charnelle d'un continent souvent réduit à ses haillons de misère et à une poignée de clichés exotiques. C'est aussi sonder l'âme d'un peuple tourné vers l'invisible. Et c'est, surtout, découvrir une prose follement exubérante, échevelée, grouillante d'inventions formelles - ce que Rushdie a appelé la «chutneyfication» de l'anglais... Avec, toujours, les mêmes navettes entre le microscopique et le cosmopolite, le régional et l'universel: comme si la grande Histoire n'avait de sens que dans sa confrontation aux toutes petites histoires du quotidien. Reste que l'on ne connaît, en Europe, qu'une partie de l'iceberg: la littérature anglophone. Elle est certes magistrale, mais elle occulte les autres littératures indiennes, parfois frappées d'ostracisme. Elles jouent pourtant un rôle capital, avec des auteurs qui déplorent cet impérialisme sournois. «Je devine, chez certains écrivains anglophones indiens, une sorte de parti pris postcolonial», soupire Nirmal Verma, un ténor qui persiste à écrire ses fictions en hindi. «J'éprouve un sentiment de frustration», renchérit Maniyambath Mukundan, qui écrit en malayalam, la langue du Kerala - Etat du sud-ouest de l'Inde. Ce débat, évidemment, renvoie à des réalités socio-politiques complexes, dans une nation où une petite minorité de la population parle anglais. Toutes les autres langues forment une foisonnante mosaïque, avec un flot d'écrivains que les éditeurs français boudent trop souvent, hélas! En novembre 2002, grâce aux Belles Etrangères, nous avons pourtant pu en découvrir quelques-uns. Parmi eux, débarqué du lointain Karnataka, Anantha Murthy. Son magnifique Samskara. Rites pour un mort (traduit du kannara aux éditions de l'Harmattan) est une condamnation féroce de la société traditionnelle hindoue: peinture au vitriol d'un village de brahmanes étouffant dans un carcan de rituels stériles... Réhabiliter traditions indigènes et cultures populaires. Pour mieux connaître toutes ces littératures en langues vernaculaires, il faut lire Ragmala, une précieuse anthologie que publieront prochainement les éditions de l'Asiathèque, sous la direction d'Anne Castaing. On y retrouve des météores qui écrivent en tamoul, en ourdou, en pendjabi, en telougou, en marathi, en malayalam, en kannara, en bengali - la courageuse Taslima Nasreen, par exemple, ou Mahasweta Devi, «la nouvelle Mère Teresa de Calcutta», qui met sa plume au service des miséreux - et, surtout, en hindi. Comme Krishna Baldev Vaid, qui a traduit Beckett et Racine, Alka Saraogi, dont Gallimard a publié le délicieux Kali-katha, Udayan Vajpayee, le poète qui doit autant à Tagore qu'à Octavio Paz. Ou encore Nirmal Verma, auteur d'Un bonheur en lambeaux (Actes Sud), éblouissante plongée dans les entrailles de la rabelaisienne Delhi. Tous ces écrivains ont les mêmes objectifs : tourner le dos aux nostalgies rétrogrades, réhabiliter traditions indigènes et cultures populaires, démonter les rouages d'une société où les anciens repères sont désormais totalement périmés. |
|
Envoyez un courrier électronique à
webmaster@terreindienne.org pour
toute question ou remarque concernant ce site Web.
|